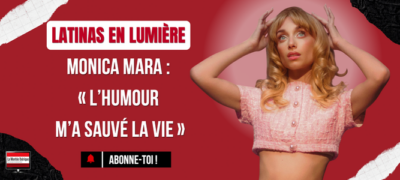Une mini-série pop, psychédélique et ultra référencée débarque sur Netflix. Une superstar /Superestar, nouvelle création des producteurs de Veneno, brosse un portrait délirant de la célébrité à l’espagnole. Mais peut-elle parler à ceux qui n’ont jamais vu Crónicas Marcianas ni fredonné un boléro kitsch ? On a regardé.

Superestar, disponible sur Netflix à partir du 18 juillet, est une mini-série espagnole en six épisodes qui mêle biopic fantasmé, satire médiatique et pop culture ésotérique. Créée par Nacho Vigalondo (Timecrimes, Colossal) et produite par le duo star Los Javis (Veneno, La Llamada, La Mesías), la série s’attaque à une figure culte de la télévision espagnole des années 2000 : Tamara, devenue Yurena.
Mais qui est cette héroïne étrange au look improbable et à la voix autotunée ? En France, peu connaissent son nom, et encore moins son parcours.
Tamara/Yurena : icône culte ou mirage télévisuel ?
Superestar comment vous dire, c’est un ovni qui arrive sur Netflix. Venu tout droit de la planète Espagne, la mini-série vous fait découvrir une culture coloré, un brin délirante en retraçant l’histoire d’une chanteuse pas comme les autres. Une forme de lady Gaga espagnole qui chamboule tout sur son passage.
Synopsis : Tamara, une chanteuse underground à l’aura étrange, rêve de reconnaissance dans un univers médiatique dominé par l’excentricité. Un soir, une comète traverse le ciel espagnol et bouleverse les lois de la célébrité. Du jour au lendemain, Tamara et d’autres figures marginales comme Leonardo Dantés ou Tony Genil deviennent les idoles du moment. Entre satire sociale, comédie dramatique et réalisme magique, la série réinvente cette époque dans un univers kitsch, coloré et surréaliste, oscillant entre opéra pop et fable interdimensionnelle.
Derrière le personnage excentrique que met en scène Superestar, il y a une véritable chanteuse : Tamara Macarena Valcárcel Serrano, née à Séville en 1969 (à ne pas confondre avec la chanteuse romantique Tamara, née en 1984). Tamara/Yurena s’est fait connaître à la fin des années 1990 dans des émissions télévisées populaires comme Crónicas Marcianas ou Aquí hay tomate, au sein d’un microcosme médiatique où la célébrité semblait s’attraper comme une grippe.
Figure d’un trash télévisuel revendiqué, Tamara a longtemps été moquée, adorée, réinventée. Elle a changé de nom plusieurs fois — Tamara, puis Ámbar, puis Yurena — et tenté de percer dans la chanson avec des titres aujourd’hui devenus cultes pour une génération de spectateurs espagnols bercés par l’excentricité du petit écran.
Une superstar ou une héroïne improbable… devenue légendaire
Le choix des comédiens n’est pas anodin. C’est Ingrid García-Jonsson, actrice hispano-suédoise, souvent associée à des rôles indie (Hermosa Juventud, Ana de día), qui incarne Tamara/Yurena. Elle apporte à ce rôle fantasque une étrangeté retenue, à la fois décalée et touchante. Ce n’est pas une imitation, c’est une incarnation et franchement, elle est méconnaissable.
Autour d’elle, on retrouve des visages connus de la télé et du cinéma espagnols : Natalia de Molina, actrice plusieurs fois primée, Carlos Areces et Pepón Nieto, figures du cinéma comique, ou encore Secun de la Rosa, habitué des seconds rôles truculents.
Ce casting volontairement bigarré reflète l’univers même de la série : un mélange de vétérans de la télé populaire, de visages queer-friendly et de performers du théâtre musical. Une constellation à l’image de l’Espagne télévisuelle des années 2000… mais relue à travers un prisme contemporain.
En misant sur des personnalités affirmées et décalées, Superestar célèbre des corps, des voix et des carrières qu’on voit peu ailleurs. Un choix cohérent, et profondément politique.
L’ovni visuel et narratif : Los Javis et Nacho Vigalondo, les nouveaux Almodóvar ?
Dès les premières minutes, Superestar impose une esthétique délibérément outrancière : couleurs saturées, costumes tapageurs, musiques vintage et univers télévisuel fluo. Ce goût du kitsch narratif et visuel est une marque de fabrique des Javis, alias Javier Ambrossi et Javier Calvo. Comme dans Veneno ou Paquita Salas, ils puisent dans la culture populaire pour la sublimer à travers des figures souvent marginales, entre tendresse et satire.
Ils assument un style pop, queer et baroque, où l’excès devient langage. Ici, la télévision trash des années 2000 se transforme en terrain de jeu visuel, mais aussi en miroir d’une société obsédée par la visibilité.
À leurs côtés, Nacho Vigalondo apporte sa touche de science-fiction existentielle, comme il l’avait fait dans Colossal ou Timecrimes. L’intrusion du fantastique (notamment avec la comète) agit comme un révélateur : derrière la folie du showbiz, il y a une réflexion plus profonde sur l’identité et le destin.
Ensemble, ils livrent un objet hybride, entre satire et opéra pop intergalactique — un véritable ovni télévisuel, sans compromis, ni mode d’emploi.
La critique de la rédaction
Je dois l’avouer : Superestar ne m’a pas attirée immédiatement. Peut-être parce que je ne suis pas une inconditionnelle du duo Los Javis. Je reconnais volontiers leur créativité et leur capacité à proposer des œuvres fortes La mesías en est un bon exemple, mais leur goût prononcé pour l’exagération me laisse parfois perplexe. Leur style est singulier, sans concession, et même si certaines de leurs productions m’ont séduite, j’aborde toujours leurs projets avec un peu de prudence.
Avec Superestar, on retrouve leur patte reconnaissable : une mise en scène outrancière, très codifiée, qui assume totalement le kitsch et joue à fond la carte de la nostalgie. Une stratégie qui parle sans aucun doute au public espagnol, bercé par les souvenirs d’une époque pop haute en couleur. À l’international en revanche, le pari est plus risqué. Il faudra voir si les références culturelles parfois très spécifiques sauront trouver un écho auprès d’un public non initié. Mais ce choix audacieux est aussi ce qui rend la série intéressante : dans un paysage dominé par des productions espagnoles très formatées pour plaire au marché mondial, Superestar fait figure d’exception.
C’est une série résolument ancrée dans son pays, qui assume ses références et qui pourrait bien surprendre, justement parce qu’elle ne cherche pas à lisser son identité. Et ce n’est pas un défaut.
La série soulève aussi des questions intéressantes : comment une société peut-elle mépriser certaines formes de culture populaire, simplement parce qu’elles sont associées à un « sous-public » ? Le parcours de Yurena, décriée et moquée parce qu’elle ne correspond pas aux standards artistiques dominants, illustre bien cette dynamique. Superestarredonne une forme de légitimité à ces figures trop souvent reléguées au rang d’anecdotes kitsch.
Alors oui, parfois, j’ai eu du mal à m’accrocher. La narration part dans plusieurs directions, le ton oscille entre satire, émotion et délire visuel. Mais ce patchwork d’intentions, aussi déroutant soit-il, fait aussi partie de la patte de Los Javis. On aime ou on déteste. Personnellement, j’ai été touchée par certains clins d’œil, amusée par d’autres, et parfois un peu perdue. Mais au moins, la série a le mérite de ne ressembler à aucune autre.
Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, sachez qu’un documentaire intitulé Je suis toujours une superstar accompagne la série sur Netflix. On y retrouve la véritable Tamara, qui revient sur sa carrière mouvementée et rencontre pour la première fois les comédiens qui incarnent sa vie à l’écran. Une mise en abyme touchante et révélatrice.